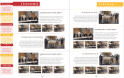Le diamant noir du Bugey livre tous ses secrets
.jpg?fit=crop-center&p=w-sm,webp)
Créé en 1973, le syndicat des trufficulteurs du Bugey (rebaptisé en 2010) compte aujourd'hui une centaine d'adhérents situés dans un « triangle » allant d'Ambérieu, Belley, à Seyssel, mais aussi des cantons limitrophes de Savoie et Haute-Savoie. « Le but premier est d'arriver à une production de truffes conséquente de façon à mettre en avant le produit », souligne son président, Eric Hell. Mais produire de la truffe n'est pas simple et nombreux sont les facteurs à prendre en compte pour obtenir le diamant noir du Bugey. Explications : « Quelqu'un qui veut se lancer doit avant tout vérifier si son terrain est favorable. La truffe aime les terrains calcaires. Il suffit de déposer une goutte d'acide chlorhydrique pour s'en assurer. S'il y a effervescence, c'est bon. Sinon, une analyse de sol peut être réalisée en laboratoire. Le syndicat travaille avec le laboratoire Teyssier, basé dans la Drôme ». Mais un terrain favorable ne garantit pas pour autant le succès. Autres conditions nécessaires : avoir des parcelles bien exposées, que le terrain soit propre et drainant.
Disparition progressive des truffières sauvages
.jpg)
Les truffières sauvages étaient très présentes dans le Bugey jusqu'après la guerre. Eric Hell raconte leur déclin progressif... : « On trouvait la truffe généralement sous les chênes pubescents. Les racines étaient naturellement mycorhizées avec le champignon, souvent en bordures de vignes un peu exposées. A partir du 20ème siècle elles disparaissent petit à petit du fait de l'exode rural et de l'abandon des terrains agricoles. En France, près de 2 000 t étaient récoltées dans les années 1900, pour environ 40 t aujourd'hui. Dans les années 70, les trufficulteurs demandent à l'Inra d'étudier le développement de la truffe. A force d'expérimentation, les chercheurs ont produit des arbres dont les racines sont contaminées avec des spores de truffe. Aujourd'hui, les pépiniéristes proposent une quinzaine d'essences: du chêne, tilleul, charme, noisetier, mais aussi des pins... que l'on choisit en fonction de la nature du terrain. Il est recommandé de choisir deux ou trois essences différentes pour multiplier les chances de réussite ».
Récolte : jusqu'à une tonne les bonnes années
.jpg)
.jpg)
La surface des truffières des adhérents du syndicat est estimée entre 60 et 100 ha ; qui produisent de 300 kg/an à une tonne les bonnes années. « Une mauvaise année se caractérise par exemple par une sécheresse de printemps qui va empêcher les truffettes de naître. S'il n'y a pas de pluie, il faut impérativement des orages au mois d'août. Cette année, on craignait la catastrophe du fait d'un automne sec, mais c'est moins pire que prévu. L'an passé a été exceptionnel, avec près d'une tonne récoltée », ajoute le président du syndicat. Dans le Bugey, comme ailleurs, il existe deux sortes de truffes : la noire, dite du Périgord (Tuber melanosporum) qui se ramasse de mi-décembre à mi-février et la truffe de Bourgogne (Tuber uncinatum) qui pousse à partir de septembre-octobre. « On trouve cette dernière surtout dans les endroits frais, sur des versants un peu boisés. Elle se vend un peu moins bien car son goût est moins prononcé, mais autour de Dijon les chefs l'ont remise au goût du jour », ajoute Eric Hell. Sur le marché aux truffes de Saint-Champ, créé en 2010, on ne trouve que de la truffe noire. A 11 h, l'ouverture se fait « à la cloche ». Chaque année, il attire entre 200 et 500 personnes qui viennent acheter le fameux diamant noir qui régalera leurs papilles durant les fêtes (voir encadré).
Patricia Flochon
Entretien d’une truffière, à chacun sa méthode
Les trufficulteurs du Bugey travaillent différemment leur terrain. « Certains choisissent de travailler le sol autour des arbres assez profondément avec une houe et sectionnent les racines, ce qui permet de redévelopper le réseau racinaire. D’autres optent pour un travail plus léger, un simple binage pour aérer. On peut également faire une taille de printemps et d’été afin que l’arbre ne pousse ni trop vite ni trop haut. Un arbre qui pousse trop va faire de la feuille mais pas de truffe. On peut également opter pour un apport d’inoculum », explique Eric Hell. Le syndicat propose des avantages tarifaires pour l’achat des plants, en partenariat avec les pépinières Robin situées à Gap. Il faut attendre généralement une dizaine d’années pour obtenir une véritable production, sachant que le noisetier aura tendance à produire plus rapidement que le chêne.Comment la déguster ?
.jpg)